 Par Marc LORIOL, Sociologue, IDHES Paris 1
Par Marc LORIOL, Sociologue, IDHES Paris 1
Le discours dominant sur l’économie présente le détricotage du droit du travail, la désindustrialisation, la montée des inégalités, comme des nécessités économiques. Les droits sociaux, les syndicats, les services publics sont vus comme des freins, des charges, qui pèseraient sur l’économie et les entreprises (confondues pour l’occasion). Cette idéologie vise à délégitimer tout récit alternatif, immédiatement taxé d’incompétence. Contre cette vision abstraite du travail, les romanciers, au premier chef ceux qui ont nourri leur écriture de leur propre expérience du monde du travail et de l’entreprise, nous racontent une autre histoire, d’autres points de vue.
Des fermetures programmées pour le profit
La gouvernance des entreprises est de plus en plus centrée sur les bénéfices à court terme pour les actionnaires plutôt que vers l’investissement dans l’appareil productif et les relations sociales. Les investisseurs cherchent à acquérir des entreprises dont la qualité des produits est reconnue, qui n’ont pas trop de dettes et des effectifs suffisants, qui n’ont pas encore délocalisé leur production, qui disposent d’équipements performants. En réduisant les effectifs, en délocalisant, en sous-traitant à moindre coût certaines tâches, en gelant les investissements, en exploitant les brevets existants, le but est d’augmenter la rentabilité à court terme.
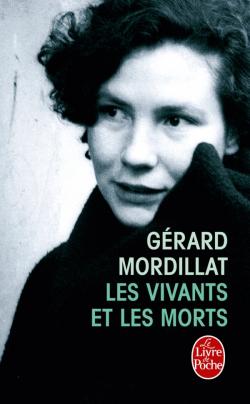 Gérard Mordillat, ancien ouvrier (dans l’imprimerie) devenu écrivain et documentariste a retracé à travers plusieurs romans la chronique de la destruction des sites industriels du Nord et de l’Est de la France. Dans Les vivants et les morts, un groupe allemand contraint une de ses entreprises françaises à licencier une centaine de personne, réduire les primes et supprimer le treizième mois. Aucun investissement n’ayant été fait depuis des années, l’équipement est obsolète et tombe souvent en panne, ce qui plombe la productivité. Avec le soutien financier des pouvoirs publics, de nouvelles machines-outils sont commandées, mais à une entreprise du même groupe qui n’est pas la plus compétitive. Seules trois des six machines commandées sont livrées et ordre est donné de les renvoyer au constructeur pour un soi-disant vice caché. En fait, c’est vers une autre filiale du même groupe, en Espagne, que devraient être envoyées les machines pourtant financées par l’aide publique. Puis le groupe Allemand vend toutes ces entreprises à un holding américain, domicilié dans un paradis fiscal. Ce nouveau propriétaire ne s’intéresse en fait qu’aux brevets, aux licences et à la marque qu’il entend valoriser dans des pays à bas coût de main d’œuvre. Il dépose brutalement le bilan et se retire totalement du jeu, laissant les fournisseurs, les salaires et les primes de licenciement impayés.
Gérard Mordillat, ancien ouvrier (dans l’imprimerie) devenu écrivain et documentariste a retracé à travers plusieurs romans la chronique de la destruction des sites industriels du Nord et de l’Est de la France. Dans Les vivants et les morts, un groupe allemand contraint une de ses entreprises françaises à licencier une centaine de personne, réduire les primes et supprimer le treizième mois. Aucun investissement n’ayant été fait depuis des années, l’équipement est obsolète et tombe souvent en panne, ce qui plombe la productivité. Avec le soutien financier des pouvoirs publics, de nouvelles machines-outils sont commandées, mais à une entreprise du même groupe qui n’est pas la plus compétitive. Seules trois des six machines commandées sont livrées et ordre est donné de les renvoyer au constructeur pour un soi-disant vice caché. En fait, c’est vers une autre filiale du même groupe, en Espagne, que devraient être envoyées les machines pourtant financées par l’aide publique. Puis le groupe Allemand vend toutes ces entreprises à un holding américain, domicilié dans un paradis fiscal. Ce nouveau propriétaire ne s’intéresse en fait qu’aux brevets, aux licences et à la marque qu’il entend valoriser dans des pays à bas coût de main d’œuvre. Il dépose brutalement le bilan et se retire totalement du jeu, laissant les fournisseurs, les salaires et les primes de licenciement impayés.
Dans Rouge dans la brume (2011), le représentant des salariés d’une autre  entreprise en lutte explique aux médias : « Pourquoi l’entreprise fermerait-elle, mettant plus de de trois cent personnes au chômage ? Ni pour des raisons structurelles, ni pour des raisons de perte de compétitivité. Uniquement pour des raisons financières. Ce qui est inacceptable, honteux. Les actionnaires du groupe veulent toucher le beurre, l’argent du beurre et je reste poli pour ce qu’ils veulent de la crémière. Avec la fermeture de la Meka, ils escomptent empocher non-seulement les fonds publics mais les dividendes produits par la délocalisation de l’usine en Serbie. Comment justifier la suppression d’un seul emploi quand vous engrangez en un trimestre 666 millions d’euros de bénéfices nets ? » (185)
entreprise en lutte explique aux médias : « Pourquoi l’entreprise fermerait-elle, mettant plus de de trois cent personnes au chômage ? Ni pour des raisons structurelles, ni pour des raisons de perte de compétitivité. Uniquement pour des raisons financières. Ce qui est inacceptable, honteux. Les actionnaires du groupe veulent toucher le beurre, l’argent du beurre et je reste poli pour ce qu’ils veulent de la crémière. Avec la fermeture de la Meka, ils escomptent empocher non-seulement les fonds publics mais les dividendes produits par la délocalisation de l’usine en Serbie. Comment justifier la suppression d’un seul emploi quand vous engrangez en un trimestre 666 millions d’euros de bénéfices nets ? » (185)
Un savoir-faire ouvrier dénié
Les ouvriers qui perdent leur emploi perdent aussi un savoir-faire reconnu et qui donnait sens à leurs efforts. Ils perdent également l’appartenance à un collectif qui valorisait leur conception du travail bien fait et les protégeait contre la tentation de sacrifier la qualité sur l’autel de la rentabilité. Avec l’éparpillement des travailleurs (vers le chômage, la préretraite, des emplois précaires, la mise à son compte…) l’autre n’est plus un collègue et un soutien, il devient une menace et un étranger. « Il y a eu un repli général après les licenciements. Plus d’invitations chez les uns, chez les autres ; plus d’apéro pour un ou pour un non, plus de pots de départ, plus de retrouvailles au Cardinal à l’heure de la messe ou du marché. Chacun chez soi a été promulgué comme une règle commune » (Les vivants et les morts, p. 258). A propos du licenciement des salariés les plus âgés : « Il n’y a pas que les souvenirs des luttes dont Format (le directeur) s’est délesté, il y a aussi le métier, ceux qui savent de l’intérieur comment tourne la boite, à qui on ne peut pas dire faites ci ou faites ça parce qu’ils savent comment ça marche, ce que ça coûte, ce que ça rapporte ». (Les vivants et les morts, p. 267-68).
 Dans Ce qu’il nous faut, c’est un mort (2016), Hervé Commère, décrit, en s’inspirant de l’histoire des ouvrières couturières de Lejaby, comment un collectif de travail soudé autour du partage d’un savoir-faire et ancré autour d’une histoire locale, est volontairement détruit pour affaiblir toute velléité de résistance syndicale et préparer la vente à un fond de pension américain : redresser les comptes sur le papier, éradiquer les syndicats et la contestation, supprimer les avantages acquis, tout cela pour rendre l’entreprise plus désirable pour les acquéreurs. Il décrit comment le propriétaire, petit-fils du fondateur, engage pour cette tâche un avocat spécialisé en droit du travail dont c’est le métier. C’est d’abord au plaisir et à la fierté du travail qu’il s’attaque, par exemple en changeant les ouvrières de postes sans raison : « Aucune des couturières ne sera plus, désormais, au poste qu’elle occupait jusqu’à présent. Certaines changent simplement d’allée, retrouvent une machine similaire, qu’elles vont cependant devoir apprivoiser, ce qui peut prendre des jours avant de la sentir vraiment. D’autres changent carrément d’affectation : une qui insérait les baleines se retrouve à assembler des triangles de soie, une autre qui fixait les agrafes est désormais en charge de la piqûre principale, celles des culottes passent aux soutiens-gorge et vice versa. Plus aucune, surtout, n’est entourée des mêmes collègues. Elles se connaissent toutes, bien sûr, de même qu’elles sont capables d’assumer les différentes tâches qu’on leur assigne, mais la finesse des relations, le soin dans le détail et les gestes, la confiance, tout cela est perdu et ne reviendra pas avant des semaines ». Puis les avantages sont rognés ou supprimés (loyers augmentés, prime supprimée…) : « Casser aussi la productivité, a objecté Vincent. L’homme a souri avec un air d’évidence : — La meilleure des raisons pour annuler la prime. Puis il s’est approché de lui : — Vous perdez en productivité. Donc, vous perdez de l’argent. Donc, vous arrêtez la prime. Le tout est d’en perdre moins que ce que vous économisez ». Enfin la peur et le chantage à l’emploi, par exemple en licenciant arbitrairement tous ceux qui contestent : « Bien sûr, ils ne seront pas licenciés, nous perdrons. Mais la procédure prendra du temps. Un temps durant lequel chacun va craindre pour sa place et se faire petit. ».
Dans Ce qu’il nous faut, c’est un mort (2016), Hervé Commère, décrit, en s’inspirant de l’histoire des ouvrières couturières de Lejaby, comment un collectif de travail soudé autour du partage d’un savoir-faire et ancré autour d’une histoire locale, est volontairement détruit pour affaiblir toute velléité de résistance syndicale et préparer la vente à un fond de pension américain : redresser les comptes sur le papier, éradiquer les syndicats et la contestation, supprimer les avantages acquis, tout cela pour rendre l’entreprise plus désirable pour les acquéreurs. Il décrit comment le propriétaire, petit-fils du fondateur, engage pour cette tâche un avocat spécialisé en droit du travail dont c’est le métier. C’est d’abord au plaisir et à la fierté du travail qu’il s’attaque, par exemple en changeant les ouvrières de postes sans raison : « Aucune des couturières ne sera plus, désormais, au poste qu’elle occupait jusqu’à présent. Certaines changent simplement d’allée, retrouvent une machine similaire, qu’elles vont cependant devoir apprivoiser, ce qui peut prendre des jours avant de la sentir vraiment. D’autres changent carrément d’affectation : une qui insérait les baleines se retrouve à assembler des triangles de soie, une autre qui fixait les agrafes est désormais en charge de la piqûre principale, celles des culottes passent aux soutiens-gorge et vice versa. Plus aucune, surtout, n’est entourée des mêmes collègues. Elles se connaissent toutes, bien sûr, de même qu’elles sont capables d’assumer les différentes tâches qu’on leur assigne, mais la finesse des relations, le soin dans le détail et les gestes, la confiance, tout cela est perdu et ne reviendra pas avant des semaines ». Puis les avantages sont rognés ou supprimés (loyers augmentés, prime supprimée…) : « Casser aussi la productivité, a objecté Vincent. L’homme a souri avec un air d’évidence : — La meilleure des raisons pour annuler la prime. Puis il s’est approché de lui : — Vous perdez en productivité. Donc, vous perdez de l’argent. Donc, vous arrêtez la prime. Le tout est d’en perdre moins que ce que vous économisez ». Enfin la peur et le chantage à l’emploi, par exemple en licenciant arbitrairement tous ceux qui contestent : « Bien sûr, ils ne seront pas licenciés, nous perdrons. Mais la procédure prendra du temps. Un temps durant lequel chacun va craindre pour sa place et se faire petit. ».
Avec Bois II (2014) la romancière Elizabeth Filhol, qui a travaillé dans le 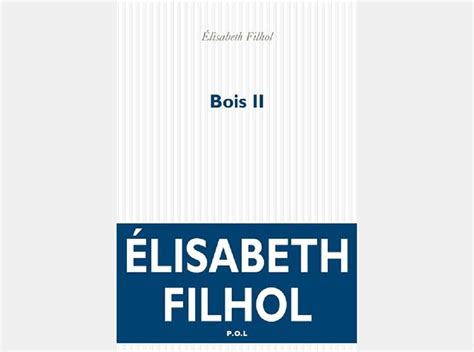 domaine de la gestion et notamment dans le conseil aux comités d’entreprises, retrace la liquidation judiciaire organisée d’une entreprise bretonne d’échafaudage industriel. Cette entreprise, Fortin (du nom de son fondateur), qui a succédé aux mines d’ardoises et de fer, a été innovatrice et pionnière dans son domaine, mais est cédée, à la mort de son fondateur au groupe Pechiney, qui récupère ainsi les brevets, les savoirs faire et la bonne réputation du produit puis met en œuvre une première restructuration. Pechiney est ensuite racheté par le canadien Alcan qui envisage de réduire ses capacités de production en Europe. Pour éviter un couteux plan social (et ne pas avoir à payer la dépollution du site), Alcan préfère revendre à un investisseur, Mangin, qui promet de reconvertir le site vers la production de panneaux solaires. Mais aucun investissement n’est fait, la marque ayant été revendue à une entreprise polonaise (dont les ouvriers ont été formés par des salariés expérimentés de l’ex-Fortin), la production en France continue sans la marque. Le produit, perdant de sa notoriété ne se vend qu’à plus faible prix. Un début d’activité d’importation (et non de production) de panneaux solaires commence sur le site, mobilisant trois salariés sur la centaine de l’usine. Mangin qui ne passe qu’une fois par semaine sur le site, fini pas envoyer aux représentants du personnel une lettre les avertissant qu’il n’est pas certain de pouvoir continuer à verser les salaires. Ils apprennent alors que l’entreprise a déposé le bilan est se trouve en redressement judiciaire. Mangin leur propose de se tourner exclusivement vers l’importation et la commercialisation de panneaux solaires afin de garder un petit nombre d’emplois non précisé. « Il se projette déjà dans l’après, l’après de la production industrielle au sein de son groupe, remplacée par d’autres activités plus rentables, plus immédiatement profitables et sans toute cette lourdeur derrière. Un cabinet d’étude et d’expertise technique, des immeubles de bureau gérés par sa société immobilière, des placements défiscalisés via la holding au Luxembourg, toute la boite à outil de l’ingénieur nouvelle formule, plus friand d’ingénierie financière que d’innovation technologique » (p. 124).
domaine de la gestion et notamment dans le conseil aux comités d’entreprises, retrace la liquidation judiciaire organisée d’une entreprise bretonne d’échafaudage industriel. Cette entreprise, Fortin (du nom de son fondateur), qui a succédé aux mines d’ardoises et de fer, a été innovatrice et pionnière dans son domaine, mais est cédée, à la mort de son fondateur au groupe Pechiney, qui récupère ainsi les brevets, les savoirs faire et la bonne réputation du produit puis met en œuvre une première restructuration. Pechiney est ensuite racheté par le canadien Alcan qui envisage de réduire ses capacités de production en Europe. Pour éviter un couteux plan social (et ne pas avoir à payer la dépollution du site), Alcan préfère revendre à un investisseur, Mangin, qui promet de reconvertir le site vers la production de panneaux solaires. Mais aucun investissement n’est fait, la marque ayant été revendue à une entreprise polonaise (dont les ouvriers ont été formés par des salariés expérimentés de l’ex-Fortin), la production en France continue sans la marque. Le produit, perdant de sa notoriété ne se vend qu’à plus faible prix. Un début d’activité d’importation (et non de production) de panneaux solaires commence sur le site, mobilisant trois salariés sur la centaine de l’usine. Mangin qui ne passe qu’une fois par semaine sur le site, fini pas envoyer aux représentants du personnel une lettre les avertissant qu’il n’est pas certain de pouvoir continuer à verser les salaires. Ils apprennent alors que l’entreprise a déposé le bilan est se trouve en redressement judiciaire. Mangin leur propose de se tourner exclusivement vers l’importation et la commercialisation de panneaux solaires afin de garder un petit nombre d’emplois non précisé. « Il se projette déjà dans l’après, l’après de la production industrielle au sein de son groupe, remplacée par d’autres activités plus rentables, plus immédiatement profitables et sans toute cette lourdeur derrière. Un cabinet d’étude et d’expertise technique, des immeubles de bureau gérés par sa société immobilière, des placements défiscalisés via la holding au Luxembourg, toute la boite à outil de l’ingénieur nouvelle formule, plus friand d’ingénierie financière que d’innovation technologique » (p. 124).
L’entreprise possède un entrepôt en proche banlieue parisienne dans un quartier en pleine réhabilitation et dont la valeur réelle (bien supérieure à celle inscrite au bilan) pourrait permettre de maintenir les salaires et de relancer la production. L’insolvabilité de l’entreprise est le fruit d’une politique délibérée de la part d’Alcan et de Mangin, ce dernier n’ayant réalisé que des dépenses qui lui étaient favorables à lui et non à l’entreprise (mouvements de fonds en faveur de sa holding, location de locaux et de véhicules en leasing, « lignes de crédit, subventions, prestations refacturées aux filiales », etc.). « Toute son intelligence mise au profit d’un portefeuille d’actifs qui grossit, et enfle, et la certitude de pouvoir encore grossir et toujours accumuler davantage. » (p. 133)
L’entreprise, objet de spéculation
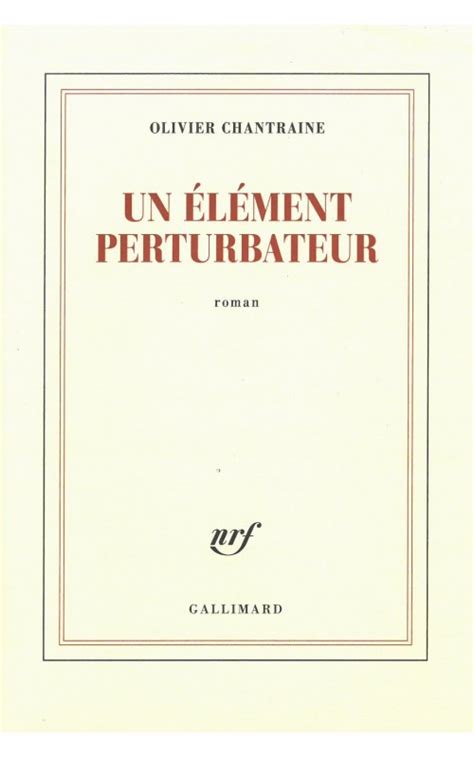 Olivier Chantraine ancien cadre d’une multinationale agroalimentaire qui a créé une biscuiterie artisanale bio décrit avec humour, dans son premier roman (Un élément perturbateur, 2017) les liens troubles entre le monde de la fusion-acquisition et le monde politique. « Je travaille pour l’influente autant que secrète Offshore Investment Company. Un petit monde de quinze personnes échappant à toute logique, au cœur du VIIIe arrondissement. À tout contrôle aussi. Ici les associés se creusent les méninges pendant des heures pour créer les meilleurs montages financiers permettant à leurs clients d’investir et de ressortir de boîtes dans lesquelles ils ne mettront jamais les pieds, sans que l’argent ne transite jamais par la France. »
Olivier Chantraine ancien cadre d’une multinationale agroalimentaire qui a créé une biscuiterie artisanale bio décrit avec humour, dans son premier roman (Un élément perturbateur, 2017) les liens troubles entre le monde de la fusion-acquisition et le monde politique. « Je travaille pour l’influente autant que secrète Offshore Investment Company. Un petit monde de quinze personnes échappant à toute logique, au cœur du VIIIe arrondissement. À tout contrôle aussi. Ici les associés se creusent les méninges pendant des heures pour créer les meilleurs montages financiers permettant à leurs clients d’investir et de ressortir de boîtes dans lesquelles ils ne mettront jamais les pieds, sans que l’argent ne transite jamais par la France. »
Du fait son incapacité à mentir, le narrateur est inadapté à ce monde de la finance et de l’optimisation fiscale. Il est toutefois associé à un projet trouble de vente à un groupe japonais d’une entreprise agro-alimentaire très largement surcotée. L’objectif est de dégager une forte plus-value permettant de financer la campagne du ministre des finances et futur candidat à la présidentielle. « Le business plan de Laura est génial, comme d’habitude, mais j’ai de gros doutes sur la capacité des Japonais à l’exécuter correctement, surtout avec la bande de truffes de Français à la tête de la boîte aujourd’hui. Je fais part de mon scepticisme à Laura. Elle me répond d’un air las que j’ai tendance à oublier que nous sommes payés pour que les affaires se fassent, coûte que coûte, et que le schéma d’optimisation fiscale imparable proposé par notre bonne Offshore Investment Company se chargera d’alléger le coût de l’acquisition in fine. » Il s’agit alors de rendre l’entreprise la plus rentable possible, mais juste sur le papier : « Pour ma part, aidé par mes fidèles employés administratifs, je m’emploie à cosmétiser comme il faut les comptes des diverses sociétés rattachées à la holding. L’ensemble des schémas juridiques et fiscaux ont été préparés en vue de la cession, et nous avons suffisamment fait le ménage dans les bilans pour valoriser au maximum la cession de l’entreprise aux Japonais. »
Avec les fusion-acquisition l’entreprise devient l’objet de « deals », c’est-à-dire de vente et revente avec le maximum de plus-value à court-terme. Par un travail comptable, des licenciements et des baisses d’investissement pour augmenter la valeur boursière, il s’agit de rendre la mariée la plus belle possible pour de fructueuses opérations. Cela est qualifié de « création de valeur » alors qu’il s’agit de captation de richesse (et non de création de nouvelles richesses) ; d’autant que les entreprises en sortent fragilisées à long terme. Comme l’ont montré les recherches sociologiques de Valérie Boussard, ce travail se fait d’autant mieux que l’on ne connaît pas l’entreprise et les personnes qui y travaillent : l’objectif est de construire une image purement financière et non de rentrer dans les détails techniques et humains ! Dans cette vision de l’économie, les salariés ne sont plus vus comme des producteurs, mais comme des charges, des résistances, pour la « création de valeur ».
Dans Le poisson pourrit par la tête (burn-out), Michel Goussu (2015) décrit 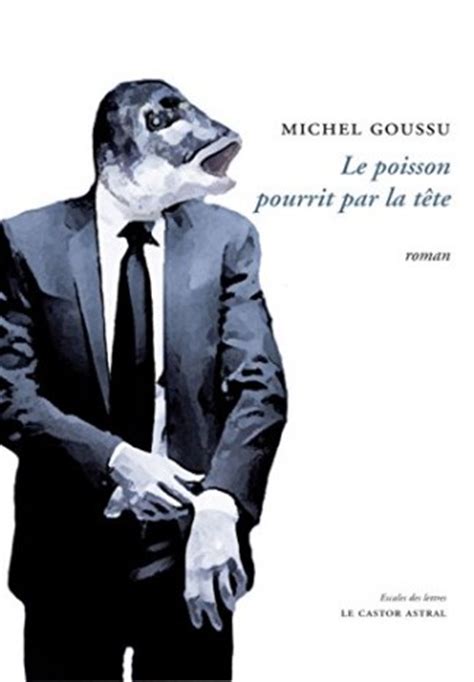 le « burn-out » vécu par un cadre moyen du secteur de l’assurance. Il souffre de se mettre au service d’une activité financière qui ne tourne plus que pour ses propres intérêts, au détriment de l’économie réelle. « L’argent peut aussi faire de jolies cascades ; les Assets Managers arrosent les sociétés d’assurance-vie, qui arrosent leurs commerciaux, qui arrosent les conseillers de gestion de patrimoine. Mais qui remplit la bouteille ? Qui finance ce petit système de rétrocommissions, pas du tout occulte, tout à fait légal ? L’économie réelle. Les délocalisations, les licenciements. Mais l’économie réelle, dans ce petit bar, on n’avait pas vraiment le temps d’y penser. » (p. 42) Plus loin, le narrateur déclare : « Je ne veux pas que mon fils me dise : « papa, c’était bien de travailler dans la finance quand elle flinguait l’Europe, mettait la Grèce sous tutelle, intensifiait à dessein la guerre économique sur tous les continents » (p. 185).
le « burn-out » vécu par un cadre moyen du secteur de l’assurance. Il souffre de se mettre au service d’une activité financière qui ne tourne plus que pour ses propres intérêts, au détriment de l’économie réelle. « L’argent peut aussi faire de jolies cascades ; les Assets Managers arrosent les sociétés d’assurance-vie, qui arrosent leurs commerciaux, qui arrosent les conseillers de gestion de patrimoine. Mais qui remplit la bouteille ? Qui finance ce petit système de rétrocommissions, pas du tout occulte, tout à fait légal ? L’économie réelle. Les délocalisations, les licenciements. Mais l’économie réelle, dans ce petit bar, on n’avait pas vraiment le temps d’y penser. » (p. 42) Plus loin, le narrateur déclare : « Je ne veux pas que mon fils me dise : « papa, c’était bien de travailler dans la finance quand elle flinguait l’Europe, mettait la Grèce sous tutelle, intensifiait à dessein la guerre économique sur tous les continents » (p. 185).
Plutôt que la difficile étude de gros pavés d’économie politique, la lecture des quelques romanciers qui décortiquent avec sagacité notre nouveau monde économique peut nous armer pour résister aux fausses évidences du discours libéral, le plaisir de la lecture en plus !